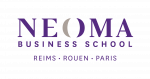Suite au déconfinement du printemps 2020, nous avons assisté à une priorisation du retour à l’école, privilégiant les enfants d’infirmièr·e, enseignant·e, policier·e ou ayant des difficultés scolaires. Dans cet article, nous montrons que ce choix, bien que moralement acceptable et difficilement contestable, n’en demeure pas moins une violence symbolique faite aux femmes cadres exerçant à des postes bénéficiant d’une grande autonomie.
La priorisation mène à une “invisibilisation spatio-temporelle” du travail des femmes cadres. Devant prendre en charge leurs enfants, elles exercent leur activité professionnelle à la marge du temps professionnel – le soir ou les week-ends – et des lieux professionnels puisqu’elles ne peuvent se mêler à la société qu’à moins que leur mari n’assume le foyer (dans les couples hétérosexuels).
D’aucuns diront que ce mauvais moment est temporaire. Nous arguons plutôt que cette priorisation du retour à l’école met en valeur que les femmes doivent toujours se battre pour avoir le “droit de travailler” dans nos sociétés capitalistes contemporaines. Nous pensons également que cette crise nous ramène progressivement à une division sexuelle du travail. Six mois peuvent suffire à bloquer certaines carrières, surtout s’ils font suite à plusieurs congés maternité. Cette mise en retrait temporaire ne sera pas sans conséquence sur l’écart de salaire entre hommes et femmes. De même que cette division sexuelle du travail cantonne les femmes dans des métiers moins bien rémunérés.